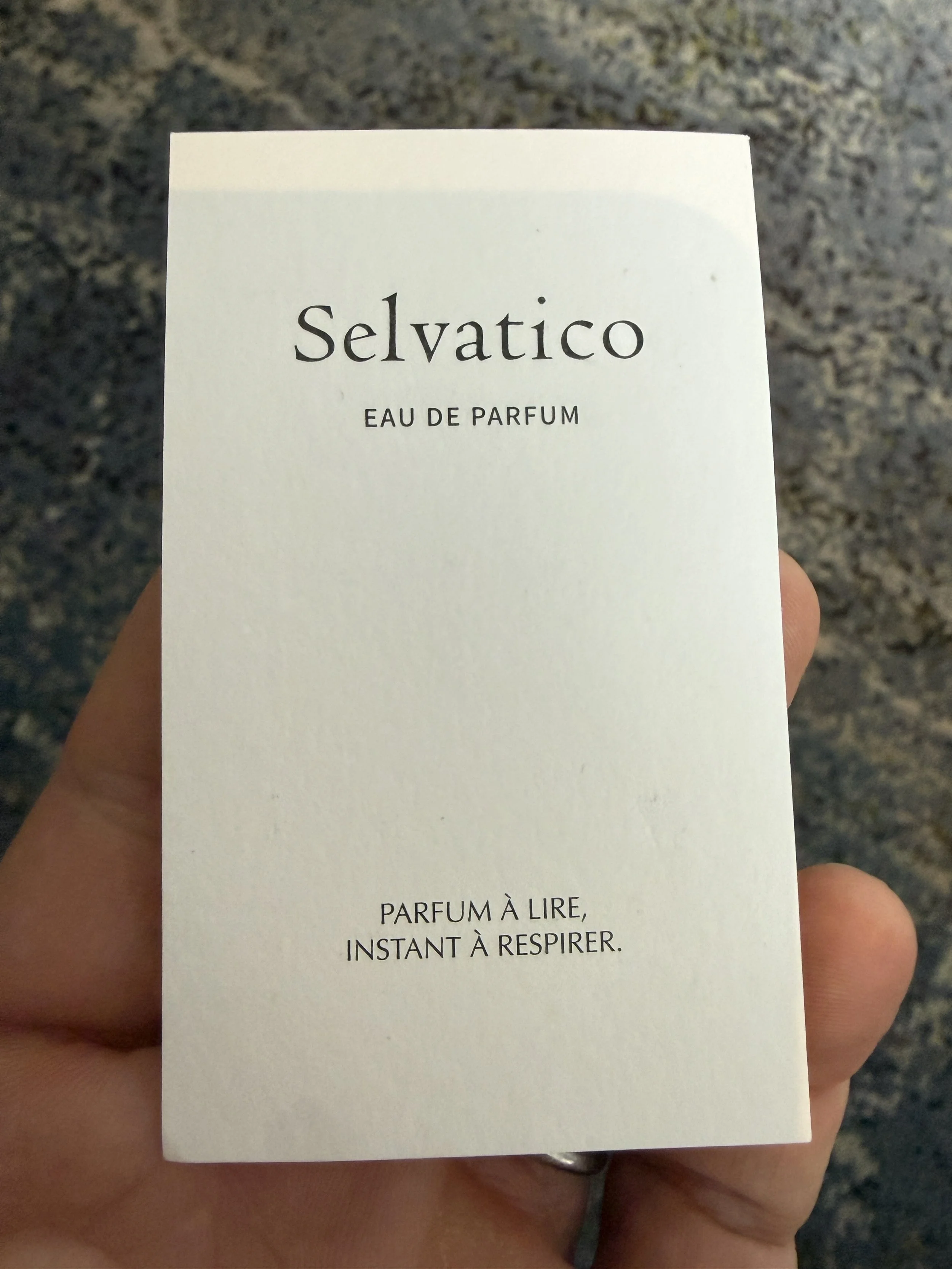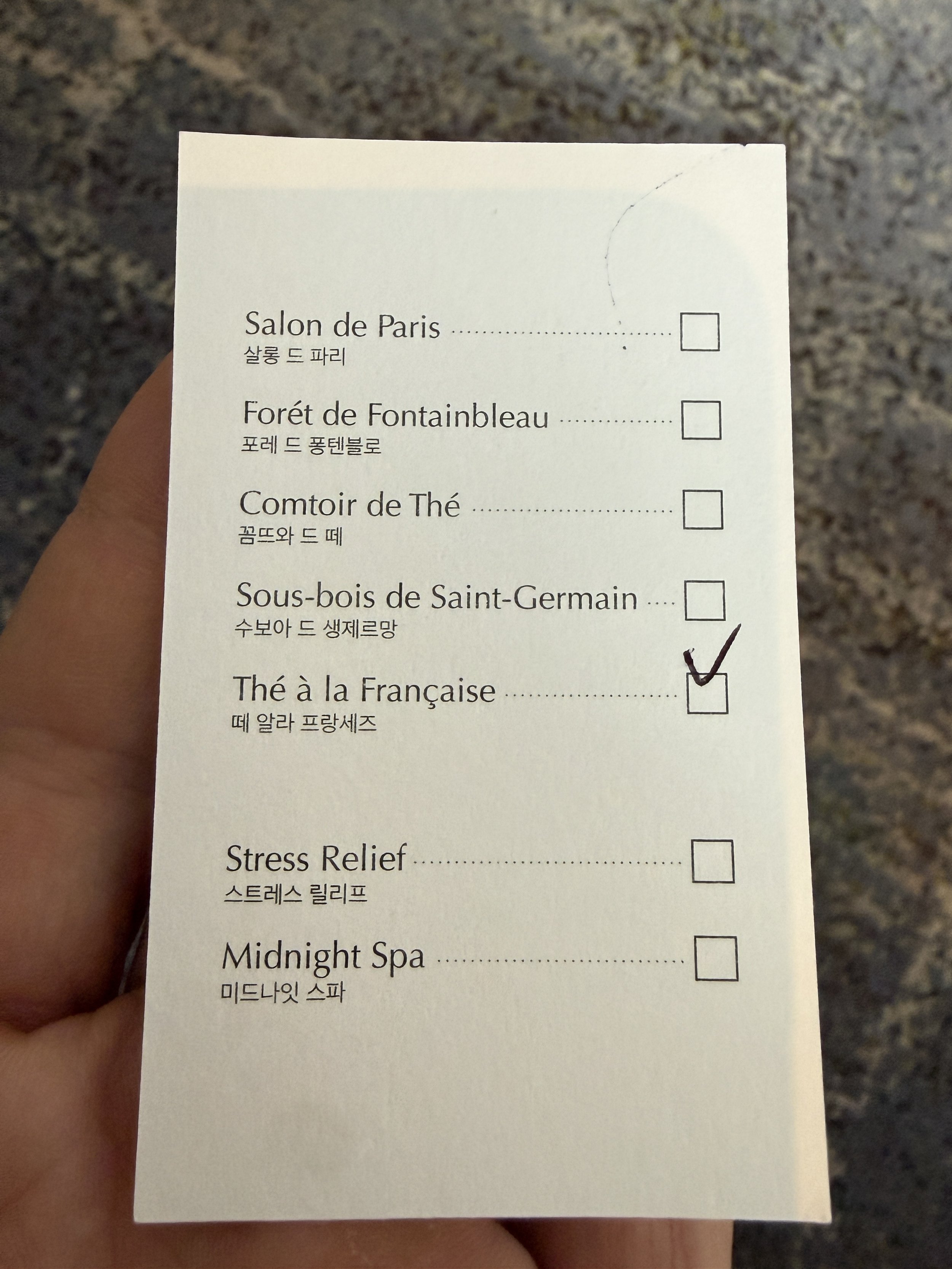Une leçon française après l’exploration de six métropoles asiatiques
Je rentre de trois semaines en Asie.
Six villes : Tokyo, Kyoto, Séoul, Hong Kong, Shenzhen, Singapour.
Pourquoi ce voyage ?
D'abord parce que j'étouffais. L'ambiance française, les affaires à l’arrêt, la tension sociale, le chaos politique, rendent l’atmosphère irrespirable. Alors, quand j’ai eu l’occasion de m'échapper, je l’ai fait. La bas, une fenêtre s’est ouverte : des rencontres de haut niveau, des pistes de collaboration, et surtout l'occasion de comprendre où en est vraiment la tech asiatique.
Pourquoi l’Asie ?
Parce que j'ai passé quinze ans à travailler avec les Américains, notamment avec TED et au sein de Boma. Je connais leur grille de lecture. Cette fois, je voulais comprendre l'autre bloc. Voir ce qui fait peur, ce qui fait rêver, ce qu'on peut importer, ce qu'on ne pourra jamais reproduire. Et surtout, comprendre ce que ça implique pour nous, Français et Européens. Le tout sur fond d'un constat historique vertigineux : cette partie du monde a basculé de la pauvreté à la puissance en deux générations. Une fulgurance qui interroge nos propres trajectoires.
Le bilan ?
En synthèse des six villes parcourues, Shenzhen apparait comme l'épicentre, d’une onde qui se propage vers Hong Kong, Séoul et Tokyo. Singapour partage le podium sur l'urbanisme opérationnel. La Chine donne le tempo de la ville intelligente et de l'intégration numérique, Singapour et Hong Kong suivent, la Corée capitalise sur la culture, le Japon stagne.
Premier constat, la marque France est notre levier le plus sous-exploité. Partout, elle incarne un style de vie, un luxe, une élégance, un savoir-vivre, une excellence artisanale et culturelle qui font l'objet d'une admiration réelle. C'est un capital qui vaut des points de PIB si nous apprenons à le déployer sans pudeur mal placée, en appliquant les mêmes principes dans d'autres secteurs que le seul luxe. Vendre au dehors, exporter l'art de vivre et l'ingénierie de la beauté, cesser de nous battre contre nous-mêmes : voilà une politique industrielle de l'émotion qui ne sacrifie ni l'exigence ni la technique.
Un phénomène m'a étonné dans chacune des six villes visitées : la multiplication des enseignes "françaises" partout. Prenez l’exemple de Paris Baguette à Singapour, Séoul, Tokyo. C’est une chaine de boulangeries "French style" à tous les coins de rue. Le problème ? Paris Baguette appartient à un conglomérat sud-coréen. Zéro actionnaire français. Ils ont créé une chaîne de 4000 boutiques dans le monde en vendant du "French-inspired". C'est l'absurdité totale. Les Coréens monétisent notre imaginaire mieux que nous. Les Chinois ouvrent des "French cafés" sans avoir jamais mis les pieds à Paris. Les Japonais créent des marques de maroquinerie "à la française" qui cartonnent. Tout le monde exploite la marque France.
La France et Paris demeurent une destination rêvée pour les Asiatiques. Cette promesse nous oblige à consolider notre offre d'accueil et de sécurité. Les JO ont montré ce qu'on pouvait accomplir quand l'État, la ville et les opérateurs alignent leurs agendas. Il faut étendre ce niveau d'exigence au quotidien, y compris, disons-le sans faux-semblants, peut-être au terme d'un débat public honnête, par l'usage maîtrisé de caméras intelligentes, et d’une robotique au service de la ville. C'est une condition pour réactiver notre désirabilité. Nous devons faire de Paris et des grandes villes françaises des scènes de l'excellence vécue, où sécurité, hygiène, hospitalité et émotions sont au rendez-vous.
A ce sujet, un sentiment de très grande sécurité m’a accompagné durant tout le voyage. Les données officielles corroborent : Tokyo a indice de sécurité de 75,6, Singapour 77,4, Séoul 75,8, Hong Kong 78,5, Shenzhen 74,3. Et Paris plafonne à 41,9 ! L'écart fait mal, il est sensible dans la rue. Bien sûr cela a un coût social : des caméras partout, une présence policière permanente, des systèmes biométriques, des alertes proactives. Une acceptabilité sociale différente de la nôtre.
Le point le plus controversé de ce voyage, un questionnement sur notre modèle politique qui peine à produire de l'efficacité visible et à tenir ses promesses du progrès sociale. À l'inverse, les régimes autoritaires, la plupart des villes que j’ai visité vivent sous ce régime, obtiennent des résultats tangibles en infrastructures, propreté, sécurité et croissance économique. Certes, l'efficacité autoritaire a des coûts lourds en libertés. Elle génère des dépendances systémiques et une fragilité face aux chocs. Mais nous sommes probablement allés trop loin dans l'autre sens. Il nous faut peut-être un peu plus nous remettre en question sur ce point : moins d’indignation, de fausse vertu et plus de pragmatisme…
Il nous faudra probablement dépasser les postures vertueuses et apprendre à travailler en nous replaçant au centre du jeu, à l'intersection de l'Est et l'Ouest. Pourquoi bannir le produit chinois ? Ce serait stupide et contre-productif. Pourquoi ne pas plutôt s’appuyer sur le meilleur des deux blocs (Est et Ouest) mais dérisquer ce qui est vital (pharma critique, agroalimentaire stratégique, IA souveraine) sur les usages sensibles. Pourquoi ne pas utiliser les offres étrangères les plus compétitives comme un levier en les hybridant avec notre valeur : service, design, modèles d'affaires, savoir faire métier... pour adresser notre marché européen mais aussi le marché mondial friand de notre exigence de qualité, de notre approche de l’experience et du style de vie ? Pourquoi ne pas transformer la dépendance subie en interdépendance choisie.
Accepter de créer de l'interdépendance avec chacun, affirmer notre souveraineté là où elle est stratégiquement nécessaire, et là où elle ne l'est pas ou plus, bâtir des alliances robustes. Travaillons avec tout le monde, États-Unis et Chine inclus, en bâtissant des ponts et des pare-feux. Soyons le pont entre Est et Ouest, pas le donneur de leçons.
Sur le numérique, pas de naïveté. Oui, une souveraineté est nécessaire, mais attention de ne pas tomber dans le piège de l'hyperscale. Nous n'avons pas les moyens de rivaliser sur ce terrain avec la Chine ou les USA. Focalisons-nous sur le derisking, sur l'utile souverain : couvrir 80% des usages à 20% des coûts, là où cela compte pour l'État, les collectivités et les filières exportatrices. Pour le reste, acceptons une certaine dépendance.
Ne nous laissons pas intimider par le récit asiatique et américain de la démonstration permanente. Le soft power des deux côtés est une grande mascarade, un festival de l'esbroufe, visible notamment dans la robotique humanoïde surmédiatisée alors que beaucoup de systèmes restent téléopérés. Cela ne retire rien aux prouesses réelles ; cela nous rappelle seulement que la valeur se joue aussi dans la crédibilité de long terme.
Il nous faudra croire encore plus en nous. La French Tech a démontré un savoir-faire réel. Il est reconnu à l’étranger. Ce qui nous manque est moins la compétence que la capacité à faire connaitre les pépites françaises encore trop enfermées dans le marché local. Il nous faut apprendre à mettre en scène nos forces, à conclure vite des alliances pour plus rayonner à l’international. Notre souveraineté doit être ciblée : alimentaire, pharmaceutique, numérique là où c'est critique. Et partout ailleurs, assumons la logique d'interdépendance avec des garde-fous.
Surtout, cultivons ce qui ne se commoditisera pas. À l'heure où l'abondance énergétique se convertit en abondance d'intelligence, l'émotion rare, belle, sincère demeure une ressource unique. C'est une force française. Je me souviens du talk magnifique de Raphaëlle Lebaud lors du dernier TEDxParis (si vous ne l'avez pas vu, regardez-le). Elle parle des métiers d'art et dit l'essentiel sur la manière de s'en inspirer pour tous les autres secteurs : poésie, génie, liberté, technique. Voilà les quatre piliers que nous devons sans cesse cultiver. Déclinons-les dans nos filières, du tourisme haut de gamme à la restauration, de la mode au design, des industries culturelles aux interfaces numériques.
D’ailleurs, si vous cherchez à aider vos équipes à mieux naviguer dans un contexte où la rareté, la différenciation et la création de valeur deviennent décisives, Raphaëlle développe précisément ces leviers dans la formation qu’elle porte au sein de la première collection “Adaptabilité” de Brightness Institute. Elle y propose une approche opérationnelle et sensible de l’adaptabilité : comprendre les mutations, identifier de nouveaux ressorts de singularité dans les organisations, déployer de nouvelles postures professionnelles et créer de la valeur là où elle se joue réellement.
Pourquoi cette conclusion ?
Je vous propose de revenir plus en détail sur chacune des destinations visitées…
Le Japon
Le Japon fait figure d’exception dans ce business-trip. D’abord parce que je connaissais le pays. J'étais déjà venu à Tokyo avant le Covid, invité comme ambassadeur innovation par la ville, un programme de collaboration entre Tokyo et l'Occident. Mais aussi parce que son économie n’a pas connu la même transformation que celle des autres régions visitées. J'y ai retrouvé une belle endormie. Les codes persistent : propreté obsessionnelle, civisme millimétré, service impeccable. Les taxis aux gants blancs, les foules qui se croisent sans se toucher à Shibuya, cette lumière d'automne sur la ville qui compose un tableau d'une constance désarmante.
Mais le souffle d'innovation visible des années 80 s'est figé. Découverte étonnante : leurs mega-stores tech cartonnent encore, alors que chez nous Surcouf a disparu et que la Fnac/Darty/Boulanger vivotent. Pourquoi ? Ils ont transformé l'achat tech en rituel culturel, en pèlerinage geek. L'e-commerce explose, mais le mall tech résiste en surfant sur la passion.
La jeunesse japonaise, elle, raconte une autre histoire. La K-pop déferle avec une force que je n'avais pas anticipée. J'ai vu les files devant les pop-ups coréens, entendu BTS dans les rues de Harajuku. Les vitrines, la musique de rue, les référents de la mode, tout bascule. Un glissement s'opère.
Côté politique d'innovation, j'ai eu le plaisir de retrouver Takuya Hirai, l’ex-ministre du numérique qui m'avait reçu en 2019. Constat froid et rude, le Japon n'a pas pris la vague IA comme on aurait pu l'imaginer. Pas de modèle de fondation souverain. Ils développent pragmatiquement au-dessus des modèles américains et chinois (OpenAI, Meta et Qwen, Deepseek…). Hirai a mentionné Mistral (par politesse diplomatique ?) mais surtout loué notre ambition française : viser 20% des coûts pour couvrir 80% des usages avec des solutions souveraines, ne pas confondre course à l'échelle et adéquation aux besoins stratégiques. À Nagoya, ils ont même copié Station F avec Station AI, largement financé par le public dans une logique de coopération public-privé. Conclusion, ils nous regardent jusqu’à nous copier parfois.
L’avance perçue du Japon en robotique n’est plus aussi évidente aujourd’hui. L’innovation japonaise s’est partiellement figée : l’automatisation règne dans les usines de robots, mais n’irrigue pas l’économie au-delà. Surtout, le Japon reste en retrait sur l’IA et le software, peinant à rattraper ses voisins et à produire des modèles souverains compétitifs. En revanche, l'adoption des robots domestiques est plus radicale qu'en Europe, portée par une culture et une tradition (shintoïste animiste), des familles réduites, une solitude accentuée par le Covid et un vieillissement accéléré. Mais leur vraie singularité réside ailleurs : transformer la technologie en moteur d'émotion. Deux experiences sur ce point m’ont troublé. La première, concerne ce dont je parlais la semaine passée à propos de la robotique émotionnelle. La seconde est incarnée parfaitement par le TeamLab, ce musée digital immersif qui fait migrer la valeur du fonctionnel vers le sensible et l'artistique.
Sur la mobilité, comme toujours : trains d'une ponctualité chirurgicale. Dans les rues, massivement de l'hybride Toyota, quasi aucune voiture électrique et encore moins de Tesla visible. Reflet d'une préférence nationale et d'une approche incrémentale de la transition. Le Japon reste résolument japonais et figé dans la fin des années 80…
Avant de quitter le Japon et rejoindre Séoul : un détour vers Kyoto. La ville impériale est probablement la plus familière, la plus "européenne" du parcours. Elle conjugue gastronomie, design, artisanat d'excellence et patrimoine historique. Les temples, les ruelles de bois, la trame des saisons, la cuisine kaiseki composent une mélodie douce à nos coeurs d’européens. Le rapport à la beauté, à la lenteur, à la précision manuelle m’ont offert un répit appréciable dans le tumulte de cette plongée urbaine et hyper connectée.
Séoul
Séoul m'a fait l'effet d'un coup de poing. LED monumentales en 3D qui avalent les façades, hyperconnectivité permanente, flux frénétiques. Tout parait transformé, plastifié, reconstruit à l'infini : des objets aux corps, des aliments aux objets. La ville est une smart city chaotique, résolument occidentalisée dans ses marques et standards, mais avec une arme secrète.
La K-pop et la K-beauty sont devenues des instruments de soft power incontestés. L’enseigne de cosmétiques Olive Young sert de centrale d'achat à toute la jeunesse asiatique. La K-pop restructure l'économie de l'attention et exporte un récit national désirable à l'échelle planétaire.
Les marques à connotation française pullulent dans toutes les villes visitées. Prenez Selvatico, ces parfums aux noms évocateurs qu'on trouve à Séoul. L'emballage respire le chic parisien, les descriptions évoquent la France. Sauf que Selvatico appartient à Bonjac, 100% coréen. Zéro actionnaire français.
Techniquement, je n'ai pas ressenti l'avance spectaculaire du début des années 2010. L'usage massif et bon marché des écrans LED fait exception, offrant une avance visible dans la culture visuelle urbaine. Pour le reste, même niveau qu'en Europe. La ville est certes ultra-sécurisée, des alertes push arrivent à cadence régulière sur mon téléphone. Comme si la Corée avait délibérément fait le choix d'investir le champ culturel et artistique en délaissant la tech hardware à la Chine. Un pari audacieux.
Shenzhen
Rejoindre Shenzhen depuis Hong Kong : c’est un voyage à part entière. Théoriquement cela ne dure que quinze minutes de train rapide mais en pratique, plus deux heures à cause des formalités. Passer en zone chinoise se mérite !
Mais quel choc esthétique. Shenzhen incarne la smart city par excellence : propreté impeccable, sécurité totale, circulation fluide, robotaxis en exploitation, parc automobile presque intégralement électrique, régulation du trafic par algorithme. Tout est à quinze minutes, tout est piloté par le mobile. Sans WeChat ou Alipay, tu deviens socialement et économiquement invisible. Tout y converge : identité, paiement, information, communication, mobilité.
Le tissu industriel a muté. L'usine du monde s'est muée en laboratoire planétaire. R&D et prototypage en continu, afflux de jeunes ingénieurs, grands acteurs locaux en prise directe avec les usages. J'ai visité Pudu, pépite de la robotique de service en conditions réelles (nettoyage, logistique, restauration). Les locaux de ByteDance ressemblent à un campus universitaire tellement leurs employés sont jeunes. EngineAI, pionnier de la robotique humanoïde, aligne des robots parmi les plus aboutis, challengers d'Unitree.
L'innovation à Shenzhen frappe, mais attention à la sur-communication. La plupart des robots de service qu'on voit circuler sont téléopérés, pas autonomes. J'ai visité plusieurs labos de robotique humanoïde. Les démos impressionnent : la dextérité des mains miniaturisées, les articulations fluides, l'équilibre parfait. Mais passé le show, la question demeure : à quoi serviront ces machines tant qu'elles resteront pilotées à distance ?
La vitesse d'itération reste bluffante. Le rythme d'expérimentation aussi. Mais il ne faut pas se laisser griser par la com' triomphale. Dans un coin du labo EngineAI, j'ai vu la réalité : des robots humanoïdes démembrés, pliés en deux, cabossés, empilés comme de vieilles marionnettes. L'image était saisissante.
Le contraste avec les robots japonais m'a troublé. Eux cherchent l'émotion, la connexion, l'âme dans la machine. Les Chinois optimisent la mécanique, la production, l'échelle.
Les carcasses métalliques entassées dans le labo racontaient une vérité crue : on est encore loin du fantasme hollywoodien. La prouesse d'ingénierie est réelle. L'autonomie véritable reste un mirage.
Shenzhen cristallise une stratégie claire : accélérer l'intégration verticale, industrialiser la robotique, déployer à l'échelle de la ville des services numériques hyper innovants, tester grandeur nature des modèles où logiciel, hardware et infrastructure publique convergent. La ville fait office d'exception dans le modèle chinois. Si vous en avez l'occasion, il faut la visiter.
Hong Kong
Retour sur la péninsule. Hong Kong tient debout comme peu de villes. Alliance étrange entre hyper-modernité et tradition : échafaudages de bambou face aux malls de luxe où les prix sur les étiquettes s'écrivent en quatre ou cinq chiffres. La baie reste splendide, la traversée en vieux ferry conserve son charme incomparable.
Carrefour entre l'Est et l'Ouest, HKG affiche un indice de Gini autour de 50% (parmi les plus inégalitaires au monde). On ressent la fracture plus qu'à Shenzhen. La FrenchTech y est très présente, active. Beaucoup de Français s'affairent pour proposer leurs services de médiation aux entreprises locales ou importer des produits tech de Shenzhen vers l'Europe.
Hong Kong, est devenu le sas d'accès à la machine de production la plus redoutable de la planète.
La FrenchTech locale l'a compris. Hong Kong n'est que la partie émergée de l'iceberg Shenzhen. Le front office d'un lab de R&D, de prototypage et de production géants. Quelques chiffres glanés sur l’économie du smart object conçu et produit à Schenzen : en moyenne 100 000 dollars pour prototyper. 300 000 dollars pour une première série de 3000 pièces. Un million tout compris pour lancer 10 000 unités d'un produit high tech. Le tout en quelques semaines. Vendu 300 dollars pièce, la marge brute atteint 200%. Avant marketing et distribution, certes. Mais où ailleurs sur terre peut-on transformer une idée en produit mondial avec cette équation ?
Cette plateforme de production et logistique ultra-optimisée reste la plus performante du globe. Elle a failli s'écrouler pendant le Covid mais elle se relève. Les Français sur place font le pont : ils captent les besoins européens, les traduisent en specs chinoises, supervisent la production, gèrent l'export. Un métier de passeur qui rapporte. Beaucoup s'enrichissent dans ce va-et-vient.
Singapour
La smart city tropicale obsédée par l’hospitalité. Parcs, malls, lieux touristiques, hôtels, tout est orchestré pour la fluidité.
L'expérience aéroportuaire reste exemplaire. L’aéroport de Changi, c'est d'abord des jardins suspendus, une cascade intérieure, des papillons vivants. Puis vient le choc : trois minutes chrono pour passer la douane. Scan biométrique, reconnaissance faciale, porte qui s'ouvre. Fini.
Ils ont compris un truc simple : la première impression forge l'opinion. Tu arrives à Singapour, tu te sens accueilli, respecté, attendu. L'efficacité devient hospitalité. Chez nous ? Roissy, c'est la roulette russe. Bornes biométriques en panne une fois sur deux. Files interminables. Taxis à la sauvette qui tentent de t'arnaquer dès la sortie. On ne fait rien pour que ton premier contact avec la France soit agréable.
Singapour fonctionne comme un carrefour, un espace hors du monde. Tout y est fluide, hyper safe, hyper clean, hyper fade. Seule la cuisine échappe à cette fadeur lisse : elle est délicieuse, fusion de toutes les Asies.
Mais Singapour, est aussi devenu l’endroit idéal pour observer le grand basculement chinois. La ville-État s'est transformée en refuge post-Covid pour entrepreneurs et investisseurs chinois. Son programme GIP ("Global Investor Program") propose une voie directe vers la résidence permanente pour ceux qui investissent dans l’économie locale. Malgré un durcissement des règles en 2025, la demande s’est encore renforcée, reflet d’un exode massif dû à la crise immobilière et aux incertitudes chinoises : dans les cafés de Marina Bay, le mandarin domine nettement. L'exode des capitaux et des cerveaux chinois vers Singapour n'a jamais été aussi massif.
Pourquoi fuient-ils ? Simple : ils ne peuvent plus recevoir d'investissements en dollars sur le continent. Les contrôles des capitaux se sont durcis. Les VCs occidentaux se retirent. Sans dollars, pas de scale-up international. Alors ils viennent à Singapour, ouvrent une holding, lèvent des fonds, et pilotent leurs équipes chinoises à distance. Vue de Singapour, la Chine, Shenzhen et Hong Kong inclus, traverse une crise sans précédent. La bulle immobilière a explosé, emportant avec elle l'épargne de millions de Chinois. Le marché domestique peine à redémarrer. C'est le syndrome japonais des années 90, en plus brutal. Les Chinois moyens paient le prix fort de décennies de croissance débridée.
Face à cette impasse domestique, Pékin a choisi sa stratégie : conquérir les marchés extérieurs, quitte à casser les prix, à sacrifier le social, mais toujours en créant de la dépendance. Ils l'ont fait avec l'électronique bon marché, le textile, les terres rares, le solaire. Ils le font aujourd'hui avec la voiture électrique. Demain, ce sera les composants pharmaceutiques, l'agroalimentaire, l'IA et la robotique.
À Singapour, cette stratégie se voit à l'œil nu. Les showrooms BYD et Xpeng pullulent. Les prix défient toute concurrence. La qualité s'améliore à vitesse grand V. Les Singapouriens, pragmatiques, achètent chinois sans états d'âme. Mais ils gardent leurs options ouvertes : américaines, européennes, japonaises. Ils ont compris le jeu.
Brightness Institute révèle sa 1ère collection “Adaptabilité”, 8 experts pour explorer l’adaptabilité, LA compétence clé de demain.
Et si votre organisation pouvait apprendre des meilleurs pour relever les défis de demain ?
IA, cybersécurité, géopolitique, innovation, Scénario Planning, leadership, storytelling… Brightness Institute lance sa première collection de formations “Adaptabilité” avec 9 programmes animés par des chercheurs, auteurs et experts de référence pour aider les organisations à :
Décider mieux
Coopérer plus vite
Innover sous contrainte.